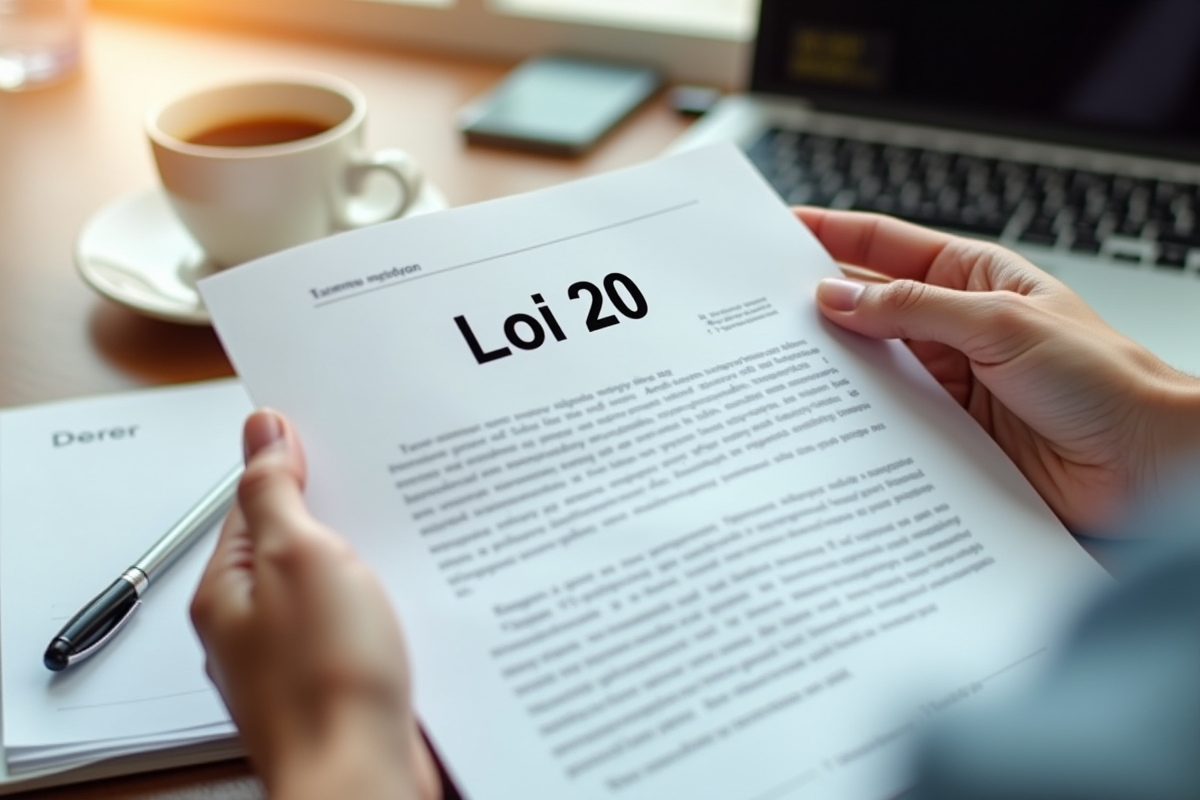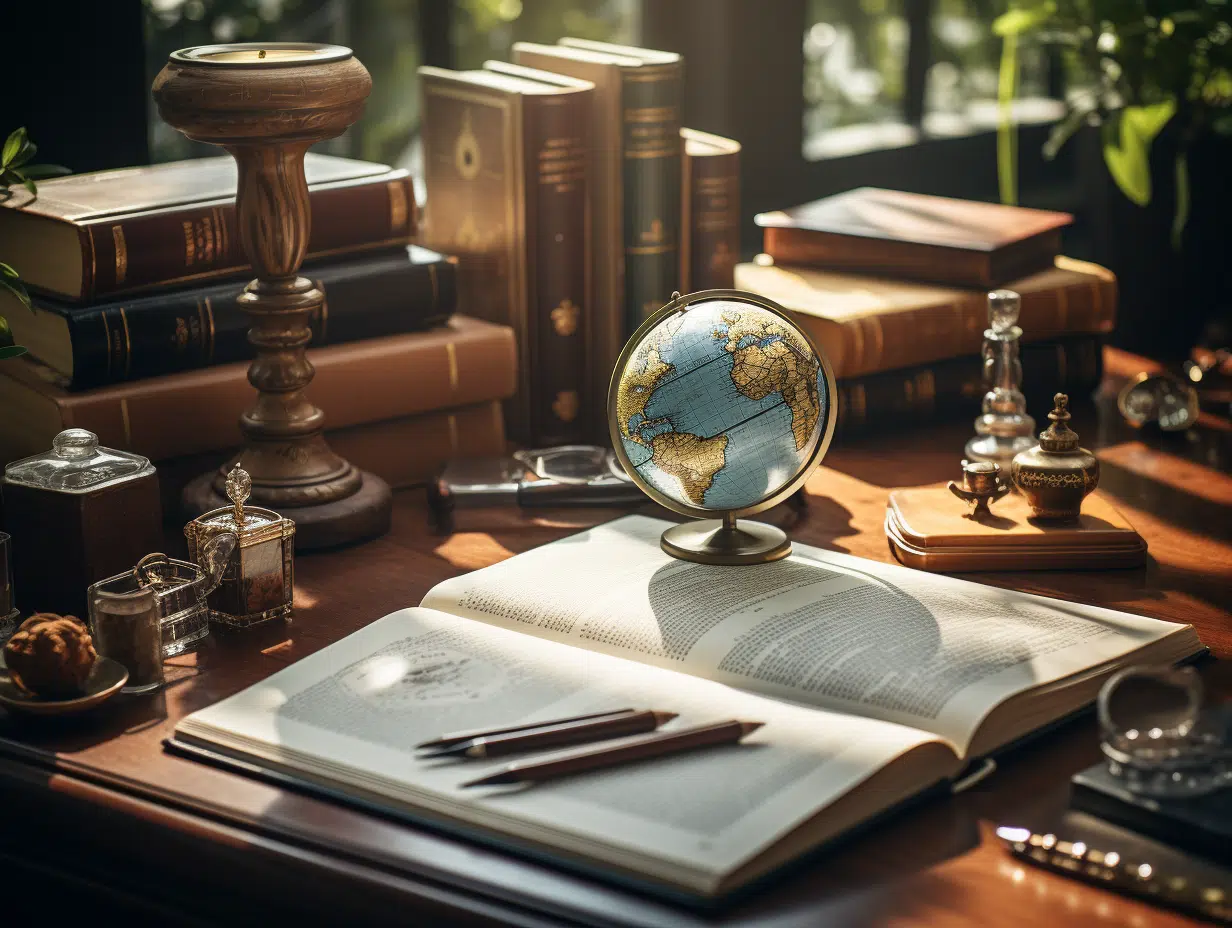Depuis le 1er janvier 2020, le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’effectue désormais au niveau de chaque entreprise, et non plus seulement à l’échelle de l’établissement. Cette révision impacte directement la gestion des ressources humaines et les pratiques de déclaration annuelle.
La loi anti-gaspillage, entrée en vigueur progressivement depuis 2021, impose aux entreprises des contraintes inédites sur la gestion, le tri et la valorisation des déchets. Parallèlement, la loi APER bouleverse le secteur énergétique en fixant de nouveaux objectifs contraignants pour la production d’énergies renouvelables sur le territoire français.
Ce que recouvre la loi 20 : panorama des récentes évolutions législatives
La loi 20 est la colonne vertébrale de la gestion budgétaire de la France. Elle s’appuie sur plusieurs piliers : la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, la loi de règlement et la loi de finances de fin de gestion. Chaque texte intervient à une étape clé du cycle budgétaire. La loi de finances initiale fixe le cap du budget de l’État pour l’année suivante ; la rectificative ajuste le tir en cours de route. Enfin, la loi de règlement vient solder les comptes à la clôture de l’exercice.
La LOLF (loi organique relative aux lois de finances) pose le cadre : elle impose une présentation claire, une discussion structurée, un vote transparent. Ce cadre renforce la visibilité sur les missions et programmes qui composent la dépense publique. Le Parlement débat et tranche, le gouvernement prépare les textes, la commission des finances garde l’œil ouvert sur l’application. Rapporteur général, rapporteurs spéciaux : ils dissèquent chaque ligne budgétaire, chaque inflexion.
Voici les leviers principaux qui structurent ce dispositif :
- Le vote des recettes et des dépenses consacre l’autorité parlementaire sur le budget.
- La commission des finances contrôle sans relâche la réalité de l’exécution.
- Les collectivités territoriales appliquent ce cadre, tout en disposant d’une certaine latitude.
La France n’est pas isolée : la logique européenne s’invite à chaque étape. Assemblée nationale et Conseil d’État se relaient, tandis que la Commission européenne surveille la trajectoire des finances publiques. La loi 20 ne se limite pas à un document technique : elle incarne la rigueur collective et la responsabilité dans la conduite des finances françaises.
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quelles nouvelles exigences pour les employeurs ?
Avec la loi 20, les entreprises voient le cadre changer. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ne se réduit plus à une formalité. Désormais, la mise en œuvre s’appuie sur des critères affinés, des contrôles renforcés, une traçabilité accrue. Les employeurs, qu’ils soient du secteur public ou privé, doivent intégrer une architecture juridique renforcée qui pousse à l’inclusion.
Les sociétés comptant au moins 20 salariés se retrouvent face à une mécanique plus exigeante. Le seuil reste identique, mais la méthode évolue. La déclaration, à réaliser chaque année auprès de l’URSSAF pour le privé, est simplifiée, mais le contrôle est plus strict. Toutes les formes de situation de handicap reconnues par le code du travail entrent dans le calcul. La sous-traitance dans le secteur adapté ne suffit plus : le quota de 6 % se mesure au plus près de la réalité des effectifs.
Pour mieux cerner ces nouvelles obligations, voici les principaux points à retenir :
- Déclaration annuelle obligatoire auprès de l’URSSAF ou de l’administration publique
- Calcul du quota en fonction de l’effectif moyen annuel
- Recours possible à des accords agréés pour favoriser l’insertion professionnelle
Une entreprise qui ne remplit pas ses obligations devra s’acquitter d’une contribution financière calculée selon sa taille et le niveau de non-respect. Cette somme alimente les dispositifs d’insertion et d’adaptation des postes pour les personnes en situation de handicap. Le droit s’ajuste en continu : la jurisprudence et les évolutions du code du travail tracent la route pour les employeurs qui anticipent.
Loi anti-gaspillage : un tournant majeur pour les pratiques des entreprises françaises
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose un rythme soutenu aux entreprises. Transformer les chaînes de production, limiter les déchets, préserver les ressources naturelles : la trajectoire est fixée, sans compromis. Les échéances se succèdent : disparition programmée des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040, réduction de 20 % de ces plastiques dès 2025, division par deux des bouteilles en plastique à l’horizon 2030. Le décret 3R balise chaque étape, forçant l’industrie à réinventer ses modèles.
Le secteur de la restauration entre dans la danse. Depuis 2023, les établissements servant sur place doivent utiliser de la vaisselle réutilisable. Les commerces de plus de 400 m² proposent désormais des contenants réemployables. Depuis 2021, le consommateur peut venir avec son propre récipient, c’est acté dans la loi. Quant aux invendus non alimentaires, interdiction de les détruire : réemploi ou recyclage obligatoire. Et depuis le 1er janvier 2024, chaque acteur gère le tri des biodéchets.
L’information des citoyens progresse aussi. Un indice de réparabilité est affiché sur neuf familles d’équipements électriques et électroniques, bientôt remplacé par un indice de durabilité. Bonus réparation, bonus-malus environnementaux, extension du principe pollueur-payeur à de nouveaux secteurs : la responsabilité élargie du producteur gagne du terrain. La commande publique, elle, doit intégrer produits issus du réemploi ou contenant des matières recyclées.
Pour mieux saisir les obligations qui s’imposent désormais, voici les mesures phares à retenir :
- Interdiction progressive de nombreux plastiques jetables
- Obligation de tri et de valorisation des biodéchets
- Don obligatoire des invendus alimentaires
- Signalement des perturbateurs endocriniens sur les produits concernés
Pilier d’une économie circulaire, la loi AGEC accélère la transformation des pratiques industrielles et redistribue les cartes de la responsabilité, à chaque maillon de la chaîne.
Loi APER et énergies renouvelables : quels impacts concrets sur la production et le secteur ?
La loi APER donne un nouveau souffle à la stratégie française des énergies renouvelables. Son application accélère la dynamique pour les développeurs, les collectivités et les industriels. L’objectif est clair : multiplier les projets solaires, éoliens, hydroélectriques, tout en consolidant leur ancrage territorial.
La planification territoriale devient centrale : les collectivités locales identifient des “zones d’accélération” où les projets bénéficient de démarches administratives allégées. Résultat : délais raccourcis, obstacles fonciers levés, critères environnementaux clarifiés. Les porteurs de projets trouvent un terrain plus prévisible, sans pour autant échapper aux consultations et à la concertation avec les riverains.
Les premiers effets se font sentir : la filière photovoltaïque voit grimper les implantations sur friches et parkings, portée par l’obligation de solariser les grandes surfaces commerciales. L’éolien terrestre gagne en visibilité sur les procédures, même si l’acceptabilité sociale reste un enjeu à surveiller.
Voici les principales conséquences concrètes de cette loi sur les acteurs du secteur :
- La simplification des démarches ouvre la voie à plus de projets collectifs.
- Les industriels s’attendent à une hausse des exigences techniques et environnementales.
- Les collectivités disposent de nouvelles marges de manœuvre, mais doivent composer avec les attentes locales.
Guidée par les objectifs européens, chaque initiative vise la neutralité carbone. La loi APER imprime le tempo : accélération, optimisation de l’usage du foncier, exigences accrues. La transition énergétique ne se contente plus de promesses : elle s’enracine dans chaque territoire, à la croisée des ambitions collectives et des réalités concrètes.