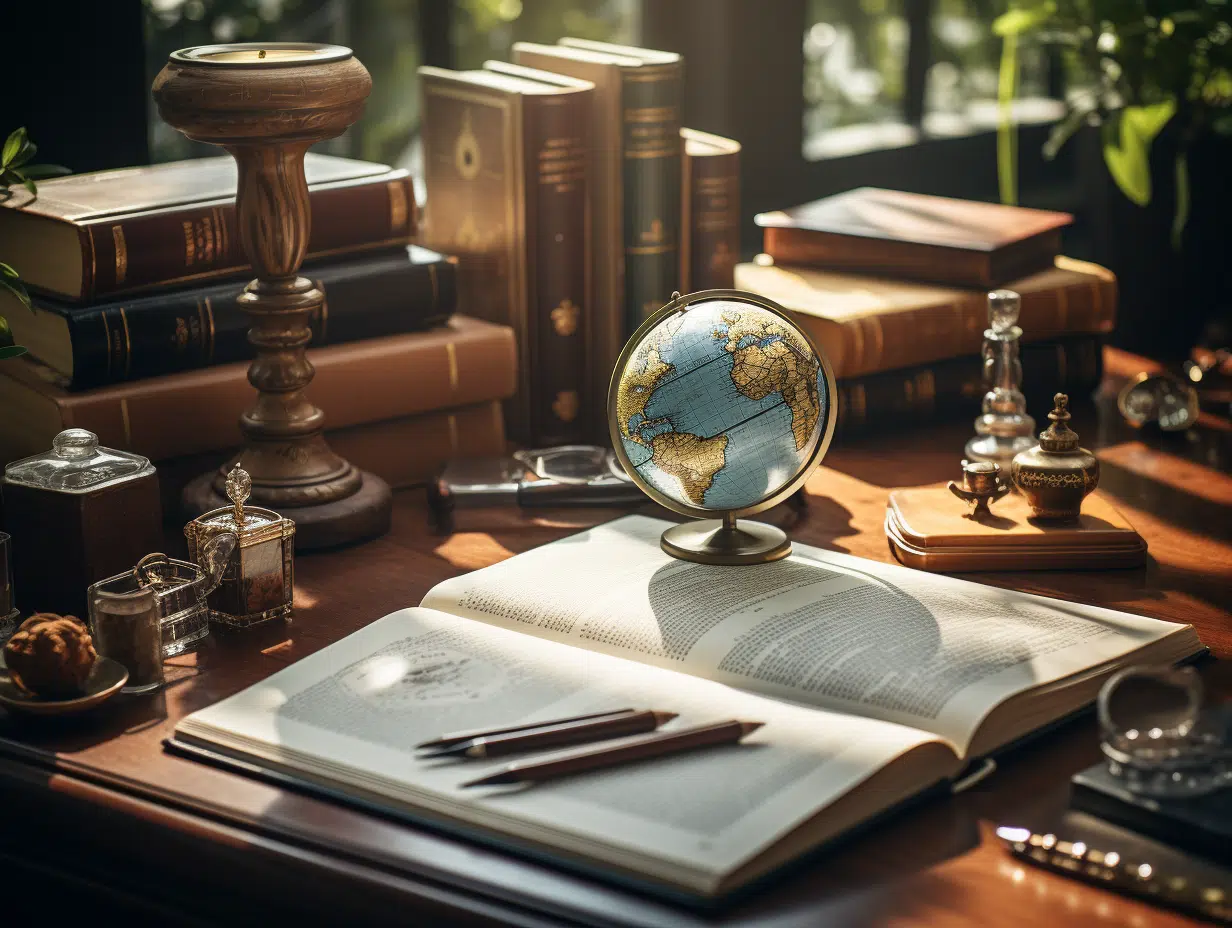Oubliez toute idée reçue : le samedi n’est pas forcément synonyme de week-end pour le Code du travail. Dans l’univers complexe des textes légaux et des conventions collectives, ce jour se glisse parfois dans le calcul des congés, au grand étonnement des salariés. Tantôt compté, tantôt ignoré, il cristallise les tensions entre règles administratives et réalités du terrain. Ce flou, loin d’être anodin, pèse sur la durée des absences autorisées et la fiche de paie. Résultat : chaque année, le même scénario se répète dans les services RH, avec son lot de contestations et d’incompréhensions.
Jours ouvrés et jours ouvrables : deux notions à ne pas confondre
Dans le quotidien des entreprises, les termes jours ouvrés et jours ouvrables sèment souvent la confusion. Pourtant, la distinction est décisive pour organiser le travail et gérer les absences. Selon le Code du travail, un jour ouvré correspond à une journée effectivement travaillée dans l’entreprise : la plupart du temps, il s’agit du lundi au vendredi, hors jours fériés et journée de repos hebdomadaire. À l’opposé, le jour ouvrable inclut tous les jours susceptibles d’être travaillés, soit du lundi au samedi, à l’exception du dimanche et des jours fériés. Autrement dit, une semaine comporte 6 jours ouvrables contre 5 jours ouvrés.
Pour clarifier ces notions, voici comment elles se déclinent dans la pratique professionnelle :
- Jour ouvré : jour où l’on travaille effectivement (du lundi au vendredi, hors jours fériés)
- Jour ouvrable : jour qui pourrait être travaillé (du lundi au samedi, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés)
- Jour calendaire : chaque jour du calendrier, sans exception
- Jour franc : période complète de 0h à 24h, utilisée dans les délais juridiques
Le nombre de jours de congés à décompter dépend directement du mode utilisé : en jours ouvrables, une semaine de congé retire 6 jours du compteur, contre 5 en jours ouvrés. L’entreprise applique obligatoirement la méthode la plus avantageuse pour le salarié, conformément au Code du travail.
La convention collective peut encore venir nuancer ces règles, ajoutant parfois une complexité supplémentaire. Selon le mode de calcul retenu, la planification RH, la gestion des absences et la compréhension du droit à congé peuvent radicalement changer. Entre semaine de travail, année civile et particularités sectorielles, chaque définition influence les droits réels des salariés et la stratégie adoptée par l’entreprise.
Le samedi, un cas particulier : jour ouvré ou ouvrable ?
Le samedi occupe une place à part dans l’organisation du temps de travail. Pour le Code du travail, il s’agit typiquement d’un jour ouvrable : potentiellement travaillé, même si, concrètement, la plupart des entreprises ferment boutique le vendredi soir. Dans la réalité, le samedi n’est donc pas un jour ouvré pour la majorité des salariés. Sauf exception, personne ne pointe ce jour-là.
Ce détail prend toute son importance quand vient le moment de décompter les congés. Si la société choisit le calcul en jours ouvrables, le samedi est systématiquement retenu dans le décompte, même si le salarié n’est pas censé travailler ce jour-là. Imaginez un congé posé du lundi au dimanche : six jours ouvrables seront soustraits, samedi inclus, indépendamment de la présence du salarié ce jour précis. La règle s’applique uniformément, sans tenir compte de l’activité réelle le samedi.
Certains secteurs font figure d’exception. Dans le commerce ou l’hôtellerie, le samedi s’impose parfois comme un jour ouvré à part entière, avec présence requise. Ce cas de figure résulte de dispositions spécifiques prévues par la convention collective ou un accord d’entreprise, qui viennent modifier les règles habituelles du décompte des congés. Il existe aussi des conventions collectives qui limitent le nombre de samedis à prendre en compte, réduisant ainsi l’impact de cette journée sur la durée des congés.
Quant au dimanche, il reste généralement hors du jeu : jour de repos hebdomadaire par excellence, il ne se compte ni comme ouvré, ni comme ouvrable, sauf cas très particuliers expressément prévus par la loi ou la convention collective.
Comment le choix entre jours ouvrés et ouvrables influence le calcul des congés payés
Le mode de décompte des congés n’est pas anodin : il détermine le nombre exact de jours retirés au compteur du salarié. Deux logiques coexistent : d’abord, le calcul en jours ouvrés (généralement du lundi au vendredi), puis celui en jours ouvrables (du lundi au samedi, hors dimanches et jours fériés). Le Code du travail prévoit l’acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables par an. En pratique, beaucoup d’entreprises préfèrent le décompte en jours ouvrés, plus transparent : 2,08 jours ouvrés gagnés par mois, soit 25 jours par an.
Voici comment ce choix se traduit concrètement dans la gestion des absences :
- En jours ouvrables : une semaine d’absence fait disparaître 6 jours du solde, le samedi compris, même si ce jour n’est jamais travaillé.
- En jours ouvrés : 5 jours seulement sont soustraits, correspondant strictement aux jours travaillés habituellement.
Au quotidien, le responsable RH doit retenir la méthode la plus favorable au salarié, sauf stipulation contraire d’un accord collectif. Les jours fériés chômés ne viennent jamais réduire le solde de congés, qu’ils tombent sur un jour ouvré ou ouvrable. L’usage d’un logiciel de gestion des congés évite la cacophonie, en intégrant automatiquement les spécificités de l’entreprise et de la convention collective.
Le passage au télétravail, au temps partiel ou à des horaires décalés ne modifie pas le nombre de jours de congés acquis. Le mode de calcul choisi demeure donc un enjeu de clarté et d’équité, tant pour la direction que pour les salariés.
Quels droits pour les salariés selon le mode de décompte des congés ?
Le mode de décompte des congés façonne très concrètement le temps de repos dont chaque salarié bénéficie. En pratique, le salarié dispose de 30 jours de congés payés par an en jours ouvrables (2,5 jours mensuels), ou de 25 jours si le calcul s’effectue en jours ouvrés (2,08 jours par mois).
Changer de méthode, c’est changer la façon de compter, mais pas la durée globale du repos. La différence ? En jours ouvrables, le samedi s’invite systématiquement dans le calcul si l’entreprise applique la règle classique du Code du travail. Un salarié qui pose une semaine complète voit alors six jours soustraits à son solde, même s’il ne travaille jamais le samedi. En jours ouvrés, seuls cinq jours disparaissent, ce qui rend la gestion des absences plus lisible.
Certains accords collectifs protègent encore davantage les salariés : limitation du nombre de samedis déduits, octroi de jours de congé supplémentaires via le fractionnement. Ce dispositif s’applique lorsque les congés principaux sont pris en dehors de la période légale, ouvrant droit à un ou deux jours de repos en plus. Les arrêts maladie, selon leur origine, n’impactent pas l’acquisition de ces congés. Le mode de calcul choisi par l’entreprise reste déterminant pour le nombre de jours qui seront réellement déduits du solde.
Pour synthétiser les différents droits, voici ce qui prévaut selon le système retenu :
- En jours ouvrables : 30 jours annuels, samedi inclus, sauf accords plus favorables.
- En jours ouvrés : 25 jours annuels, strictement sur les jours effectivement travaillés.
- Fractionnement : attribution possible de jours supplémentaires si les congés sont pris en dehors de la période principale.
Le samedi, discret mais redoutable, continue de brouiller les pistes entre employeurs et salariés. Une chose est sûre : dans la jungle des absences, mieux vaut savoir sur quel terrain on pose ses valises.